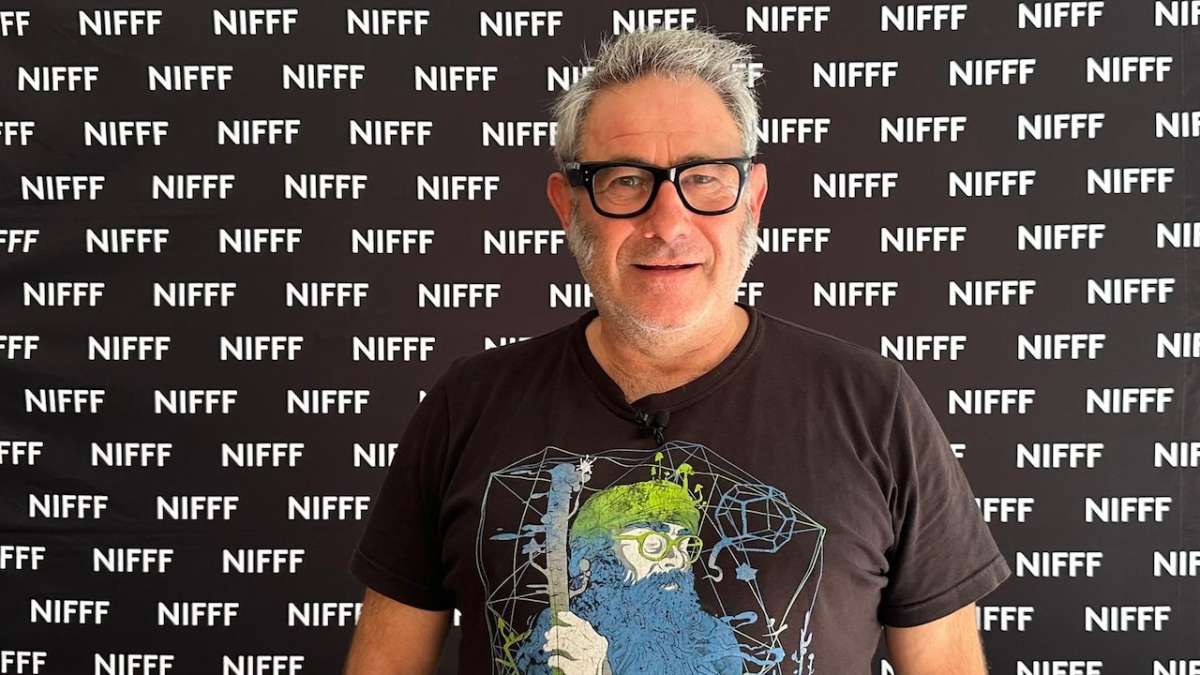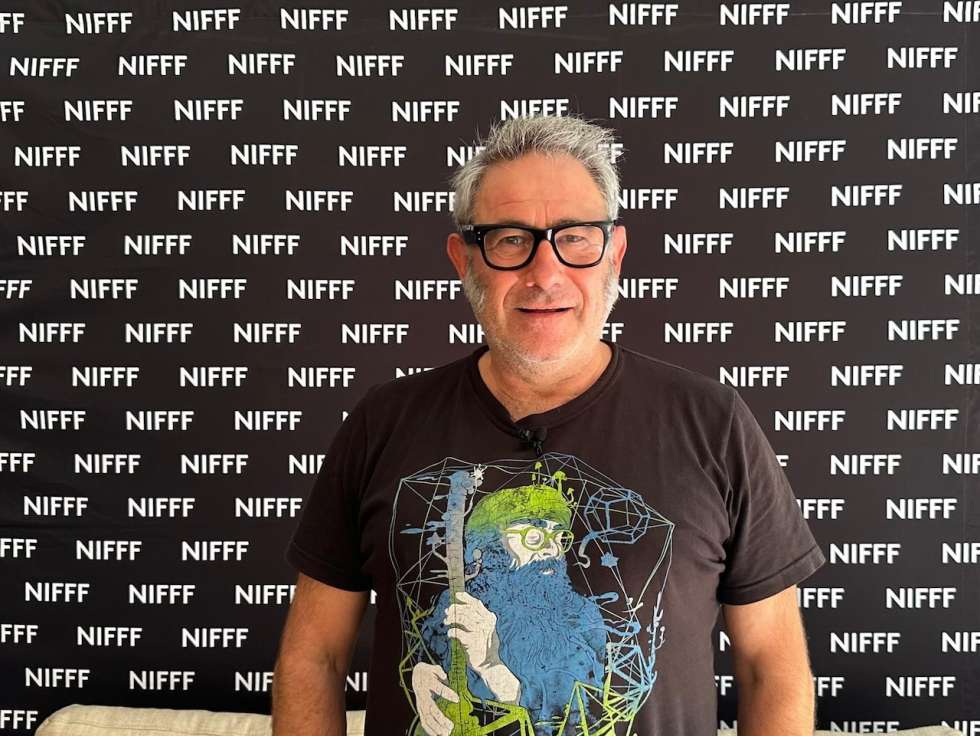SIRÂT est un film à voir absolument au cinéma. Il emmène les spectateurs à la frontière étroite entre le monde réel et la transcendance. Au Festival International du Film Fantastique de Neuchâtel, nous avons rencontré Sergi López, un acteur à l’énergie contagieuse qui nous a généreusement fait part de sa vision du cinéma et de son métier, ainsi que de son expérience particulière lors du tournage.
Sergi López | SIRÂT
- Publié le 15. juillet 2025
« Il est temps de dynamiter l'idée reçue que le cinéma est uniquement un divertissement ; le cinéma doit transformer, proposer des idées... »
SIRÂT | SYNOPSIS
Luis se rend avec son fils de douze ans dans le désert montagneux du sud du Maroc pour rejoindre une fête techno. Il cherche sa fille aînée, disparue des mois auparavant lors d’une de ces raves party insomniaques qui s’étirent sur plusieurs jours. Dans la fureur et le tumulte de ce monde qui leur est étranger, ils distribuent la photo de la disparue. Mais leur espoir s’amenuise. Quand la rave est dissoute par l’armée locale en raison de troubles politiques, ils se joignent à un petit groupe qui veut traverser le désert pour se rendre à la prochaine fête à la frontière mauritanienne. Mais la nature sauvage et aride s’avère imprévisible…
À découvrir sans hésiter en salles, SIRÂT confronte le spectateur à la frontière ténue entre monde tangible et transcendance. Face à nous, un acteur d’une énergie contagieuse qui partage avec générosité son approche du cinéma, son expérience particulière lors de ce tournage et sa vision du métier.
Le film a déjà été montré en Espagne, où certains critiques parlent de « cinéma de cruauté » [cine de crueldad] en opposition avec le cinéma « pour passer un bon moment » [para pasarlo bien]. Sergi López, comment décririez-vous SIRÂT ?
Je ne parlerais pas de cinéma de cruauté. Je trouve ça un peu trop facile, je préfère toujours la cruauté à l’entertainment pur. Autrement dit, il est temps de dynamiter l’idée reçue que le cinéma est uniquement un divertissement. Le divertissement pour le divertissement, ça ne m’intéresse pas. Pour moi, le cinéma doit transformer, proposer des idées, ouvrir sur le monde. Bien sûr, on peut distraire, mais c’est insuffisant. SIRÂT, ce n’est pas un film cruel, c’est un film sur un monde cruel. Il parle de notre époque, de ses contradictions, de sa violence, de l’injustice qui frappe l’humain. Et ça, c’est légitime. C’est même nécessaire !
On pourrait dire que le film agit comme un miroir. Il nous rend sensibles à des choses qu’on finit par ne plus remarquer.
Exactement ! Un film comme SIRÂT, rappelle que le cinéma est encore un lieu où il est possible d’exorciser certaines choses. Il nous permet de vivre des émotions fortes, presque comme si on les vivait à la première personne, mais avec cette distance propre à la fiction. Le cinéma permet de vivre des choses par procuration.
D’ailleurs, pendant qu’on parle, on vit dans un monde où un génocide est en cours, en direct. Et pourtant, on continue, on essaie de garder le sourire, de rester heureux… Comment fait-on ? Comment vivre cette dualité, entre l’horreur du réel et le besoin vital d’avancer, de croire que la vie en vaut la peine ? On a besoin de ça, de continuer à marcher, même quand tout semble insoutenable.
Vous dites que vous êtes parti sur ce projet sans références précises. C’était vraiment une page blanche ?
Moi, j’ai toujours abordé les projets comme une page blanche. Ce n’est pas par désintérêt, mais parce que je n’ai jamais eu un véritable bagage cinéphile. Je ne me prépare pas avec des références précises en tête, parfois par choix, parfois simplement parce que je ne les ai pas. Cela fait plus de vingt ans que je fais ce métier, et souvent, sur les tournages, je suis entouré de gens très cinéphiles : techniciens, électriciens, chefs opérateurs, journalistes. Moi, je ne l’étais pas vraiment. Mais avec le temps, je le suis devenu un peu. Comme je n’avais pas de modèles, j’ai dû fonctionner autrement dès le début. À l’instinct. Sans cadre prédéfini. J’abordais chaque rôle comme un terrain inconnu. Et avec le recul, je réalise que cette approche me correspond profondément. Dans la vie comme dans mon travail, je me concentre sur le présent. Ce qui compte, c’est le moment où quelqu’un dit : « Ça tourne. » C’est là qu’il faut se jeter à l’eau. Bien sûr, tout ce que tu travailles en amont est important ! Mais au fond, tu dois être là, pleinement, dans l’instant. C’est ce que j’ai ressenti, par exemple, sur SIRÂT. J’y joue un personnage qui s’appelle Luis, alors que je ne m’appelle pas comme ça. Estéban, mon fils à l’écran, n’est pas réellement mon fils. Tout le monde le sait. Tout est faux. Et pourtant, tu dois y croire ! Pour y croire, il faut une forme de foi. Pour avoir la foi, soit tu as une religion, soit un dieu, soit, comme toutes les comédiennes, tu t’accroches et tu essaies.
La foi, la croyance, la spiritualité… Ce sont des thèmes très présents dans le film, jusque dans son titre : SIRÂT, un pont ou chemin issu de l’eschatologie musulmane, suspendu entre l’enfer et le paradis, que seuls les justes peuvent franchir. Comme le rappelle une mention dans le générique d’ouverture, ce pont est aussi fin qu’un cheveu et aussi tranchant qu’une lame. C’est une image puissante. Ce rapport au spirituel et à la transcendance, qui touche profondément le réalisateur Óliver Laxe, résonne-t-il aussi en vous ?
Óliver a une spiritualité très présente. Il l’assume, il l’exprime, et son film en est profondément empreint. Moi aussi, avec le temps, la vie et mon métier, j’ai développé une forme de spiritualité. Je viens du théâtre, où le personnage n’est jamais toi. Il y a une distance. Mais avec le temps, je me rends compte que même si on garde cette distance, ce qu’on joue vient toujours toucher quelque chose de profond. Ce n’est jamais complètement neutre. Dans SIRÂT, je joue un père. Je n’ai pas pensé à mes propres enfants pendant le tournage car ils sont grands maintenant, 27 et 29 ans. Mais, ce que j’ai vécu comme père est là, quelque part en moi. Ce n’est pas volontaire, c’est physique. Mon corps, ce n’est pas juste un outil. Il sait des choses que je ne sais pas. Pour une scène très dure, j’ai dit à Óliver : « Je ne sais pas jouer ça. C’est trop. » Mais à un moment, il faut lâcher prise. On plonge, et c’est le corps qui prend le relais. J’ai beaucoup pleuré sur ce tournage, mais ce n’était pas de la souffrance. J’étais pleinement là, à jouer. Je savais que j’étais en train de faire mon métier, et j’y prenais du plaisir. Mon corps devenait un véhicule pour l’émotion. Et ça, pour moi, c’est forcément quelque chose de spirituel !
Justement, vous évoquez le corps comme un véhicule à l’émotion. Et là, vous tournez au milieu du désert, dans des conditions extrêmes. Est-ce que ça influence le jeu ?
Totalement. C’est l’avantage du cinéma par rapport au théâtre. Là, tu es dans le désert, et ce n’est pas du décor : c’est du sable, de la chaleur, du vent. Ça t’aide. Ça nourrit l’imaginaire. Même la soif, la fatigue, ça aide à y croire. Tu te dis : « Je suis Luis, je me perds dans le désert. » Même si à 8 heures, je rentre à l’hôtel. Entre-temps, j’y crois, parce que le corps sent. Il réagit et se transforme.
Le film a une identité sonore très marquée. J’imagine que la rave joue un rôle particulier, presque celui d’un co-acteur, dans votre performance ?
La rave, on l’a vraiment vécue ! On en a tourné une vraie, au tout début, à Teruel. Moi, je connaissais déjà un peu ce monde, contrairement à mon personnage : Luis. Lui, il débarque avec son fils, complètement perdu. Mais sur le plateau, c’était réel. Et après, ce qui m’a marqué, c’est en voyant le film fini, avec la musique. Au montage, tout prend une autre ampleur. Même des images sans paroles, avec juste la musique, ça raconte quelque chose. Ça crée un voyage. Et ça, je ne m’y attendais pas.
Pendant le tournage, vous ne saviez pas encore à quel moment la bande-son allait prendre de l’ampleur. Dans ce genre de configuration, il faut une grande confiance dans le réalisateur et accepter un vrai lâcher-prise. À part la rave du début, la musique n’était pas encore présente.
C’est vrai, j’aime beaucoup ce que tu dis là. On doit faire confiance. On n’a pas le choix. Comme lui doit croire que je suis Luis, moi je dois croire en sa vision. Et c’est encore plus vrai ici, parce qu’il travaille en 16 mm. Ce n’est pas comme le numérique, où on peut multiplier les prises.
Est-ce que le fait de tourner en pellicule a représenté une contrainte due au coût supérieur du traitement par rapport au numérique ?
Pas tant que ça, en fait. J’ai eu la chance de tourner plusieurs fois en 16 mm. En partie parce qu’il y a vingt ans, c’était presque la norme. On n’avait pas vraiment le choix à l’époque (rires). Et paradoxalement, on fait parfois plus de prises qu’en numérique. On ne se dit pas : « C’est bon, on en a deux, on arrête. » Non. Si on sent qu’on n’a pas trouvé, on recommence. Il y a une forme de rigueur dans ce rapport à la pellicule. Mais, ce n’est pas à nous, les comédiens, de porter ce stress-là. On est protégés. C’est l’équipe qui gère la technique, le timing, la lumière. Nous, on doit rester dans le moment, concentrés sur le jeu, sur ce qu’on est en train de vivre.
Dans le film, Luis garde une photo de sa fille, comme un talisman. Pour vous, s’il y avait une image à garder de ce tournage, une scène-talisman, ce serait laquelle ?
Il y en a deux. D’abord, cette scène où une voiture tombe dans un radeau. Je ne dirai pas plus sur cette scène-là, il faut voir le film. Elle me reste, profondément. Et puis, un moment dans le désert, avec le personnage de Rivers : on prend un hallucinogène, on danse, on entre en transe. Pour moi, c’est ça SIRÂT. De la douleur, oui. Mais transcendée. Une manière de continuer à avancer, de continuer à grandir.